La jolie cliente
Par Hugues Morin
*
- How are you today?
- Well, it’s Friday…
- Yeah…
J’ai déposé son café sur le comptoir – moitié corsé, moitié velouté – elle a payé, puis m’a sourit.
- Thank you!
- Have a good day!
Puis, prenant son café, elle s’est arrêtée sur le petit comptoir pour y ajouter sucre et lait, et a quitté l’endroit sans un regard en arrière. Si elle avait tourné la tête, elle m’aurait vu, derrière ma caisse, en train de la regarder partir.
Puis, elle m’aurait vu pousser un soupir, et retourner à mes machines à café ou servir un autre client, mon cœur battant un peu plus vite que trois minutes auparavant.
Ça fait cinq ans, et jamais je n’ai oublié le sourire qu’elle me faisait, ni la manière dont elle me disait Thank you, en appuyant un peu sur les mots, comme pour exprimer qu’elle me remerciait vraiment et ne le disait pas simplement comme un réflexe.
Cinq ans, et à l’époque, j’aimais encore que les clients m’abordent en anglais. Et celle-là, qui venait à chaque matin à sept heures trente cinq précise chercher son moitié corsé, moitié velouté, en plus de me parler dans ma langue maternelle, elle était fort jolie.
--
Je suis né en Colombie Britannique, sur le vignoble familial près de la petite ville de Summerland, dans la vallée de l’Okanagan. Certains de mes amis ont appris un assez bon français lors de leurs études primaires et secondaires. Pas moi. Je n’étais pas très intéressé par la langue, et n’étais pas très intéressé par l’école tout court. J’ai donc grandi dans un milieu unilingue anglophone, persuadé que je ne manquais rien, que ma langue était la langue mondiale, universelle. Jusqu’au jour où je suis tombé amoureux d’une copine de collège, qui elle, parlait bien français. Elle avait étudié en immersion pendant son école primaire, et avait même fait deux séjours de quelques mois en environnement français – un quelque part en province en France, et l’autre à Trois-Rivières, au Québec. Quand il lui arrivait de rencontrer des francophones et qu’elle leur parlait, je lui trouvais un petit côté exotique qui me plaisait beaucoup.
Notre relation a été passionnée et intense. Nous étions sérieux dans nos sentiments, mais trop jeunes pour établir de réels plans d’avenir sans partager exactement les mêmes rêves. Pour ma part, je ne savais pas du tout ce que je ferais dans la vie. Le vignoble familial m’ouvrait ses portes, mais mon père voulait d’abord que j’obtienne un diplôme de la faculté d’administration de UBC. Je n’étais pas convaincu de mon intérêt pour l’entreprise ni de mon intérêt pour l’administration en général. Caroline – c’était le nom de ma copine, je me rends compte que je ne l’ai pas présentée – rêvait de voyage et d’études en archéologie. Elle était fascinée par les sociétés disparues, particulièrement les Azteques, les Incas et les Mayas; elle disait qu’on savait déjà beaucoup de choses sur les anciennes sociétés des vieux continents. Moi, je n’y connaissais rien et à mes yeux incultes, ces images de temples Mayas qu’elle me montrait dans des élans de passion n’étaient que des empilements de roches sans grand intérêt.
Caroline ne m’a jamais quitté officiellement. Elle a simplement poursuivi son rêve, sa vie, sa passion, en partant étudier à Paris. L’annonce de son départ m’a profondément bouleversé., Même si nous ne nous étions pas dit adieu, nous savions tous les deux que la vie nous emmenait dans des directions différentes. Après son départ, je suis tombé dans une période de sérieuse remise en question. Trois mois plus tard, j’avais abandonné mes études au collège et je partais pour Montréal.
J’avais convaincu mes parents que c’était la meilleure chose à faire. Je ressentais soudainement le besoin de m’ouvrir sur le monde, d’apprendre une autre langue, d’apprendre à vivre ma vie. Après mon séjour au Québec, j’étais persuadé que je verrais plus clair et que je pourrais alors savoir ce que je ferais dans la vie. On a tous besoin, à un moment où un autre, de sortir du cocon familial. Dans mon cas, le plus loin serait le mieux, j’étais trop paresseux pour accomplir le changement dont j’avais besoin si je restais près de ma famille.
Le choix de Montréal s’est imposé de lui-même. Je ne voulais pas avoir l’air de suivre Caroline, donc j’avais exclu la France de mes possibilités. Je ne pense pas que j’aurais eu les moyens financiers d’emménager à Paris de toute manière. Et pour un jeune qui ne parlait pas encore français, Montréal représentait un beau filet de sécurité, la ville étant pratiquement bilingue. Je voulais y étudier le français intensivement, mais en même temps, c’était rassurant de savoir que je ne serais pas totalement perdu en cas de problèmes.
--
Après ma dernière année secondaire, j’avais déniché un emploi à temps partiel au Starbucks, et j’avais continué à y travailler pendant mon année et demie de collège. J’avais donc mis un peu d’argent de côté puisqu’en habitant chez mes parents pendant mes études, je n’avais qu’à me soucier de mes dépenses personnelles. Après mes deux premières semaines à Montréal, j’ai commencé à me chercher un travail et il m’a donc semblé naturel d’aller faire application pour un poste de barista dans les Starbucks de la ville.
De ce point de vue, Montréal est très différente de la côte ouest. Summerland est une petite ville campagnarde de onze milles âmes, et le centre-ville compte tout de même trois Starbucks. J’ai peut-être joué de chance et décroché un emploi au Starbucks du passage de la Place Bonaventure.
Je suivais mes cours de français à raison de quatre heures à tous les matins de la semaine. Je travaillais donc au café strictement en après-midi. Cette succursale du centre-ville fermait ses portes à dix-huit heures puisqu’elle desservait principalement une clientèle de gens d’affaires. Après trois mois de ce régime, la qualité de mon français avait beaucoup progressé et j’étais surpris de toute la fierté que j’éprouvais suite à cet accomplissement. J’étais encore très loin d’être bilingue, mais au moins, je pouvais me débrouiller en ville, et l’arrivée d’un client francophone au café ne provoquait plus en moi ce regard de panique dont mes collègues avaient tant ri à mes débuts. Et puis il y avait l’amusement de la découverte des différences entre les langues, les cultures, à l’intérieur du même pays.
Lorsque septembre arriva, Agathe, la gérante du café, me demanda si je ne serais pas intéressé à travailler un peu plus d’heures par semaine. Agathe était originaire de Toulon, dans le sud de la France et l’ironie du sort ne m’avait pas échappé lors de mon embauche. Elle parlait un anglais qui n’était pas bien meilleur que mon français, ce qui avait un petit côté rassurant pour moi. Pour l’automne, elle me proposait de faire des ouvertures, plutôt que les fermetures auxquelles j’étais habitué. Plusieurs de nos collègues – des étudiants – réduisaient leurs disponibilités pour entamer une nouvelle année scolaire et nous devions donc revoir les horaires. Pour ma part, j’avais toujours des cours, mais seulement deux jours par semaine. Je commençais à trouver mon travail du matin répétitif et l’offre est donc tombée à point.
C’est un jeudi, à sept heures trente-cinq, que j’ai vu ma jolie cliente pour la première fois. Les jeudis matin étaient très achalandés. En fait, il s’agissait de notre période la plus frénétique de la semaine. Moi, j’aurais cru que le vendredi serait pire, mais non, les jeudis, semaine après semaine, s’avéraient incroyablement achalandés. J’occupais la position d’expéditeur, c’est-à-dire que j’assistais les caissiers à passer les commandes au bar à espresso et à servir le café infusé et les pâtisseries aux clients en tentant de minimiser les déplacements des caissiers. Pendant deux heures entières, mes activités se limitaient donc à verser le café, servir les pâtisseries et infuser du café frais à raison de deux litres à toutes les dix minutes à peu près, et ce autant pour le café corsé que pour le velouté du jour. J’aimais bien cette position, puisqu’elle réduisait mes besoins de communication avec la clientèle francophone. Même après quelques mois, il m’arrivait encore de tomber sur un québécois que je ne parvenais pas du tout à comprendre. Quand j’occupais cette position, j’avais peu à penser et je ne voyais les clients que du coin de l’œil. Je me limitais à mettre leur café sur le comptoir et dire «merci, bonne journée». Je prononçais encore «bon» journée, le satané «onne» toujours difficile à prononcer pour moi.
Je ne sais donc pas pourquoi j’ai remarqué cette cliente en particulier, mais j’ai croisé son regard en déposant son moitié corsé, moitié velouté sur le comptoir et elle m’a remercié en appuyant son Thank you en me regardant dans les yeux.
À ce moment-là, j’ai pensé «wow, that one is cute», puis j’ai continué mon travail en oubliant tout de l’événement.
Le lendemain, elle était de retour, et cette fois, j’étais caissier. L’expéditeur était occupé à moudre une livre de café pour un autre client et j’ai donc pris la commande, et préparé le café de cette jolie cliente et lui ai servi avec un sourire qu’elle m’a retourné. Elle s’est arrêtée au comptoir pour ajouter lait et sucre, puis a filé en direction de la Gare Centrale sans un regard en arrière. J’ai pensé «Nice smile. And she is cute». Parfois, vous voyez une jolie fille du coin de l’œil, mais une partie de son charme vient de l’inconnu, et du fait qu’elle disparaîtra de votre vie cinq secondes plus tard. Ce vendredi matin, j’avais pu regarder ma cliente un peu plus que la veille, et ma foi, mon jugement sur sa beauté n’avait pas changé, il s’était même confirmé sans aucun doute.
Elle avait le teint foncé; cette belle couleur caramélisée qu’ont les latino-américaines et plusieurs filles originaires du Moyen-Orient. Ses yeux étaient d’un noir profond mais son regard demeurait plein de chaleur. Son nez, bien équilibré, n’était ni évasé ni retroussé, et ses lèvres, pleines sans être trop pulpeuses, formaient un sourire sincère qui lui éclairait le visage tel un levé de soleil. Elle portait ses cheveux noirs légèrement bouclés, aux épaules, libres de toute attache.
--
Ces événements remontent à cinq ans, mais je me souviens encore très clairement du visage et du sourire de cette joli cliente. Je me souviens aussi de sa voix. Une voix basse et chaleureuse, un peu rauque, qui rappelait la voix de l’actrice Scarlett Johannson. La comparaison m’étais rapidement venue à l’esprit puisque Scarlett était alors - et est encore aujourd’hui à bien y penser – mon actrice préférée, et qu’une partie de son intérêt en tant qu’actrice est sa voix très particulière.
Les semaines passèrent donc comme elles le font toujours, au même rythme, bien que souvent, on a l’impression que la vitesse du temps est plutôt relative. Je servais ma jolie cliente trois matins par semaine à sept heures trente-cinq. Quelque part en octobre, j’ai réalisé que j’avais hâte de travailler le mardi matin pour la revoir l’espace d’un instant, après trois jours sans avoir pu admirer son beau sourire. Cette constatation m’a forcé à un examen intérieur, mon premier depuis mon arrivée à Montréal.
Par la suite, je me suis mis à me poser des questions à son propos, à chercher à mieux la connaître, bien que nos échanges matinaux ne duraient qu’une minute. Je tentais d’élargir les propos de nos micro conversations mais la chose était difficile dans le contexte achalandé du café. Évidemment, je n’avais aucun moyen de savoir ce qu’elle pensait, mais mon ton penchait un peu vers le flirt, et elle n’avait pas l’air de s’en formaliser.
Vers la fin d’octobre, j’avais décidé d’en savoir plus sur ma jolie cliente. Elle arrivait au café à la même heure tous les matins, par le couloir qui fait immédiatement face au Starbucks. Elle empruntait donc le transport en commun. Mon problème, c’était que ce couloir donnait à la fois accès à la station de métro, au terminus d’autobus de la rive sud de Montréal et au train de banlieue. Elle portait un long manteau et des bottes et semblait toujours porter des vêtements de ville et des souliers. Pas de jeans ni d’espadrilles; j’en avais conclu qu’elle devait travailler dans un bureau.
Après avoir ajouté du lait et du sucre dans son café, elle quittait toujours le Starbucks en direction de l’escalier qui menait à la Gare Centrale. Je me disais qu’elle devait travailler quelque part entre la station Bonaventure et la Place Ville-Marie. Si elle avait travaillé plus loin – dans la Tour de la Place Montreal Trust, par exemple – elle aurait certainement emprunté le métro McGill plutôt que Bonaventure. Mais mon raisonnement ne tenait la route que si elle n’empruntait pas par le train de banlieue ou l’autobus, auquel cas elle aurait marché plutôt que de prendre le métro jusqu’à McGill, puisque cette station se trouvait sur une toute autre ligne.
De toute manière, ces déductions ne pouvaient me mener bien loin. Et l’édifice cruciforme de la Place Ville-Marie comptait 42 étages et abritait une redoutable quantité de bureaux.
J’ai bien tenté d’en savoir plus en questionnant mes collègues – surtout ceux qui travaillaient au Starbucks Bonaventure depuis longtemps, mais en vain. Ni Nicolas, ni Daniel, ni Michel, les trois autres gars qui travaillaient le matin, ne savaient qui elle était ni d’où elle venait, ni où elle travaillait.
Pire, aucun ne semblait ne l’avoir remarqué avant que mon intérêt envers elle ne devienne évident à leurs yeux. Pour moi, leur aveuglement était surprenant, mais un jour de début novembre, Michel me confia que nous avions tous une jolie cliente, une cliente favorite, et que chacun de nous ne remarquait pas réellement les autres clients. Je devais lui donner raison sur ce dernier point. J’avais plusieurs habitués que je pensais connaître un peu lorsque je travaillais en BC, et pourtant, après seulement quelques mois passés à Montréal, je n’arrivais même pas à évoquer le souvenir d’un seul d’entre eux. Par contre, l’argument de Michel était faible puisque j’avais tout de même remarqué la cliente préférée de chacun de mes collègues. Il faut dire que les femmes de Montréal me semblaient bien plus belles que celles de la BC. Je mettais alors ce jugement sur l’attrait de la nouveauté de certains traits et sur l’exotisme que la langue française évoquait pour moi.
Au début décembre, même les filles qui travaillaient avec moi me taquinaient sur ma jolie cliente. Elles pouvaient voir mon sourire quand je lui servais son moitié corsé, moitié velouté, et au moins deux d’entre elles me conseillaient de l’inviter à sortir. Je n’étais pas nécessairement timide envers les filles, mais je ne croyais pas qu’inviter une cliente était une si bonne idée. Je n’avais pas peur d’une réponse négative, puisque ça fait partie du jeu, mais je ne voulais pas la rendre mal à l’aise de venir chercher son café tous les matins après m’avoir refusé une invitation. Bien sûr, je voulais aussi m’éviter une situation embarrassante face à elle et mes collègues. Se faire dire non était une chose à assumer, que tous les collègues le sachent en était une autre.
Enfin, je n’étais pas certain, en mon for intérieur, d’être prêt pour une nouvelle relation. L’idée était tentante, et je ressentais une attirance véritable envers cette fille, mais j’étais assez honnête avec moi-même pour savoir que je n’étais pas amoureux. Ou plutôt pas encore amoureux. Je ne la connaissais pas assez pour savoir si je serais amoureux d’elle. Une partie de moi aurait bien voulu tenter le coup et être amoureux, mais en même temps, j’avais emménagé à Montréal pour me retrouver. Je désirais définir qui j’étais et qui je serais, j’avais une idée un peu romantique face à ce séjour, et je tentais d’éviter de plonger dans une situation qui compliquerait tout avant d’avoir atteint mon but. Et puis elle semblait avoir un véritable travail alors que je ne savais pas encore quoi faire dans la vie et considérais mon emploi au Starbucks comme un travail temporaire.
--
Trois semaines avant Noël, Agathe m’a demandé de séparer mon temps au café entre les matins et les après-midi. J’avais terminé ma session de cours et mes disponibilités me permettaient de travailler un peu plus.
L’avantage de ce nouvel horaire était financier; mes quarts de l’après-midi étaient un peu plus longs que ceux du matin, et comme je travaillais plus d’heures par semaine, ma paye était un peu plus intéressante. Le désavantage était sentimental; je voyais un peu moins ma jolie cliente, que je ne servais désormais plus que deux matins par semaine.
Puis, une semaine avant Noël, une indigestion m’empêcha de travailler un vendredi matin, remettant au jeudi suivant le moment où je pourrais voir le sourire de ma jolie cliente au teint caramel. Penser qu’elle me manquerait avait un aspect inconfortable à mes yeux, mais en même temps, sentir mon cœur battre plus fort à l’idée du jeudi suivant n’était pas désagréable.
Je me souviens très bien de la discussion que j’ai eue avec mes parents pendant cette fin de semaine de décembre. Ma mère me téléphonait religieusement une fois par semaine, et depuis quelques temps déjà, me parlait de la possibilité que j’aille passer le temps des fêtes avec ma famille dans l’Okanagan. J’avais d’abord acheté la paix en ne fermant pas la porte à cette possibilité. Puis, j’avais préparé le terrain en parlant de mon budget très serré, et en cette ultime fin de semaine, j’avais annoncé que je restait à Montréal pour les fêtes. Bien que la déception pouvait s’entendre dans sa voix comme dans celle de mon père, la discussion s’est mieux déroulée que ce que j’avais anticipé. J’avais craint que ma mère n’offre de me payer le trajet, ruinant l’argument de mon budget, et au fond de moi-même, j’aurais plutôt aimer passer ce Noël en famille. Mais j’étais orgueilleux et voulais aussi projeter l’image solide de celui qui peut très bien vivre sans la famille le temps d’un Noël.
Le destin allait en décider autrement et allait me le faire savoir le jeudi matin suivant.
Il était à peine passé sept heures trente quand le téléphone du Starbucks a sonné. La chose était assez courante et m’indisposait inévitablement. Les matins étaient suffisamment achalandés comme ça sans que nous ayons à répondre aux appels du bureau chef ou des autres succursales moins achalandées. Je venais alors de rapporter du lait au bar à condiment et je plaçais les pichets vides dans le lave-vaisselle. J’étais celui le mieux placé pour répondre, et j’ai donc fait deux pas dans le petit bureau.
Quand j’ai reconnu la voix de ma mère, je lui ai dit que je la rappellerais, mais elle m’a interrompu en me disant que j’allais revenir pour les fêtes, que mon billet était réservé, qu’ils avaient besoin de moi, que mon vol était prévu pour le soir même.
J’ai d’abord voulu protester que l’histoire ne faisait aucun sens, mais comme ma mère ne m’avait jamais appelé au travail, je me sentais confus. J’ai cessé de l’interrompre et l’ai laissée poursuivre.
Du coin de l’œil, j’ai remarqué ma jolie cliente qui était au comptoir devant la caisse, commandant son café à Michel. Ce dernier a lancé un regard dans ma direction, mais son sourire espiègle a disparu de son visage quand il a vu mon expression.
À l’autre bout du fil, ma mère, en pleurs, avait passé le téléphone à mon père, qui m’a donné les détails de mon vol. Je ne me souviens pas d’avoir pris note de ces détails, mais plus tard, ils étaient bien inscrits à l’endos d’une feuille de commande de pâtisserie.
--
J’ai donc pris l’avion ce soir de fin décembre, pour rejoindre ma famille à temps pour les fêtes.
Ce Noël serait fort différent pour nous, et fort triste aussi.
Mon seul frère revenait d’une soirée au cinéma de UBC quand une voiture en perte de contrôle était venu le faucher, à une session de la fin de ses études, le laissant entre la vie et la mort, et laissant mon père et ma mère dans une torpeur que personne ne veut voir chez ses parents. Mon grand frère savait ce qu’il ferait dans la vie et jusque-là, il le réussissait bien.
Le grand sapin de Noël, dans son coin du salon, avait cessé d’évoquer la joie, de même que les présents emballés à ses pieds, et demeurés intouchés bien après la veille de Noël.
Ce Noël a été le plus triste de ma vie. Chaque jour passé en partie au chevet de mon frère à l’hôpital avait la cruauté de nous apporter de l’espoir et du désespoir tout à la fois.
Quelques jours avant la fin de l’année, j’ai appelé mes amis du Starbucks de Montréal pour leur donner des nouvelles, bien que rien de précis ne semblait se dessiner à ce moment. J’ai parlé quelques minutes avec Agathe, lui disant que je ne savais pas quand je reviendrais à Montréal. Ma mère voulait que je demeure en BC, mais je ne me sentais pas prêt à renoncer à ma vie parce que celle de mon frère avait été si violemment interrompue. Je voulais tout de même passer du temps avec mes parents, et avec mon frère. Agathe m’assura qu’elle me ferait une place sur l’horaire dès mon retour selon mes besoins et mes disponibilités. Puis, avec un sourire dans la voix, elle m’a dit que ma jolie cliente s’était informée de moi. Où j’étais, ce qui s’était passé le jeudi où elle m’avait vue pour la dernière fois, si je me portais bien… La nouvelle m’a un peu surpris et m’a fait chaud au cœur.
Quand j’ai raccroché le téléphone, je me sentais mieux et du même coup, j’ai réalisé que je m’ennuyais d’elle.
--
Mon frère est sorti de son coma après deux semaines de sommeil artificiel.
Une nouvelle année s’étalait devant nous, avec ses incertitudes, ses inquiétudes et ses bonheurs encore insoupçonnés. Mes parents avaient l’air des personnes les plus heureuses du monde. Un peu de réadaptation serait nécessaire pour que mon frère puisse récupérer totalement de son accident, et sa session universitaire était foutue, mais toutes ces choses qui semblaient si importantes quelques semaines auparavant étaient maintenant secondaire; la vie a parfois de drôle de manière de vous faire mettre les choses en perspective.
Et ma vie à moi, elle me rappelait vers Montréal, où j’étais revenu une semaine après le réveil de mon frère. Agathe m’a remis sur l’horaire, j’ai repris quelques cours de français, avec l’intention de faire un retour aux études l’automne suivant. L’année semblait prometteuse, après tout.
Et en ce début de nouvelle année, c’est par un vendredi de fin janvier que j’ai fait mon premier quart de matin au Starbucks Bonaventure. Vers sept heures trente-cinq, j’ai remarqué l’heure au bas de l’écran de ma caisse et j’ai ressenti un petit pincement à l’idée de revoir ma jolie cliente. J’avais un sourire sur le visage juste à l’idée de lui servir à nouveau son café.
- How are you today?
- Well, it’s Friday… I’m happy for your brother.
- Yeah… me too…
J’ai déposé son café sur le comptoir – moitié corsé, moitié velouté – elle a payé, puis m’a sourit.
- Thank you!
- No. Thank you… for the smile… Have a good day!
Prenant son café, elle s’est arrêtée sur le petit comptoir pour y ajouter sucre et lait, et a quitté l’endroit sans un regard en arrière. Si elle avait tourné la tête, elle m’aurait vu, derrière ma caisse, en train de la regarder partir.
Puis, elle m’aurait vu pousser un soupir, et retourner à mes machines à café ou servir un autre client.
Ça fait cinq ans, et jamais je n’ai oublié le sourire qu’elle m’a fait, ni la manière dont elle m’a dit Thank you, en appuyant un peu sur les mots, comme pour exprimer qu’elle me remerciait vraiment et ne le disait pas simplement comme un réflexe.
Je n’ai pas oublié non plus comment elle a semblé sincère en me disant être heureuse pour mon frère. Je ne pourrai jamais l’oublier puisque trois heures plus tard, j’en ai parlé avec Agathe. Elle venait de me taquiner en me disant m’avoir vu parler avec ma jolie cliente. Je lui ai rapporté ce qu’elle m’avait dit, en lui demandant comment étaient les discussions entre elles en mon absence, ce qu’elle avait demandé, comment Agathe lui avait parlé de moi, de mon frère… Agathe m’a expliqué qu’à part une fois où la jolie fille avait demandé de mes nouvelles, elles n’avaient pas parlé, qu’elle ne lui avait jamais parlé de mon frère. Elle lui avait simplement dit que j’allais bien malgré des problèmes familiaux.
Et après les avoir questionnés un par un, il s’est avéré qu’aucun autre de mes collègues ne lui avait parlé de mon frère ou de la raison de mon séjour en BC.
J’avais donc l’intention de lui demander comment elle avait pu être au courant, en imaginant aussi que cette conversation pourrait éventuellement être plus longue que nos habituels propos.
Mais je n’en aurais jamais l’occasion. Car ce vendredi de janvier, où je la revoyais pour la première fois depuis mon retour de l’Okanagan, a aussi été la dernière fois où j’ai vu le beau sourire de ma jolie cliente au teint caramel.
--
Pendant un temps, j’ai été intrigué par sa disparition de notre clientèle régulière. Un congé? Un arrêt de travail? Un accident? Un transfert? Tant de possibilités impossibles à explorer. Pourtant, je ne cessais de me dire qu’elle aurait dû me saluer, me dire au revoir, si elle avait dû partir. Son absence me rongeait. Je regrettais alors de ne jamais avoir posé de questions sur son travail, où elle habitait. Mais je ne sais pas si j’aurais eu le courage de la contacter après sa disparition même si j’avais pu.
Je me suis donc lentement habitué à son absence, mais certains matins, mon cœur se serrait, vers sept heure trente cinq, à l’idée qu’il était toujours possible que l’on me commande un moitié corsé, moitié velouté, avec une belle voix un peu rauque, et qu’en me tournant, je verrais encore le soleil se lever avec son sourire.
Les semaines ont passé, comme elles le font toujours malgré tout, et le printemps est arrivé, faisant sortir les montréalais à nouveau après que le froid hivernal ne les ait transformé en ermites, et j’ai accepté que je ne la reverrais certainement jamais.
L’arrivée du printemps a été une grande fête dans la maison de mes parents également. Mon frère avait totalement récupéré de son accident et devait faire sa dernière session de cours à UBC dès l’automne suivant. Pour ma part, j’avais fait une demande d’admission au programme de traduction de l’université McGill. Je resterais donc loin de la maison familiale, mais pour mes parents, je reprenais au moins la bonne voie.
--
Cinq ans déjà.
Et cinq ans plus tard, par une autre fin de décembre, c’est confortablement installé dans un petit chalet de St-François du Lac, à une heure de Montréal, que je me remémore ces événements et le sourire de ma jolie cliente.
Il s’en est passé des choses en cinq ans. Des Noëls en famille, d’autres célébrés seul. Une graduation en traduction et une relation amoureuse avec une jeune québécoise, qui n’a duré qu’un an mais qui a été passionnée. Deux voyages à l’étranger pour éviter de trop m’habituer au froid intense et à la neige. Et maintenant, une visite de Caroline à Montréal.
Elle a terminé ses études en archéologie, a effectué des stages en Amérique du Sud et s’est spécialisée. Elle parle aussi espagnol alors que mon français est maintenant satisfaisant. Elle aura toujours un pas d’avance sur moi.
Mais aujourd’hui, au moins, nous savons tous deux où nous voulons aller, et ce Noël dans un chalet de campagne, c’est un beau moment que la vie nous offre.
J’ai bon espoir, car ma vie à Montréal m’aura rendu optimiste. Certaines personnes sont persuadées d’avoir un ange gardien. Moi je n’en sais rien. Mais je sais que j’ai une jolie cliente. C’est un peu fou comme pensée, mais ce n’est pas plus fou que de croire qu’une simple cliente de café peut avoir changé votre vie.
Cinq ans et pas un Noël sans que je ne pense à elle. Parfois, je me demande quelle serait ma réaction si je revoyais son sourire.
-------
Hugues Morin
St-François du Lac
24-25 décembre 2005
© Hugues Morin 2005
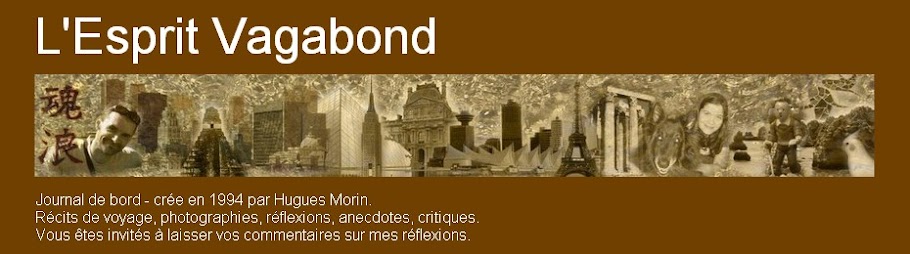
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
L'Esprit Vagabond vous remercie de vous identifier (ou signer votre commentaire). Assumez vos opinions!
L'Esprit Vagabond est un blogue privé et ne publie pas de commentaires anonymes.